Panels en réseau_Série 3 : Participation au temps de la Covid-19 - Peiner à se projeter au-delà de 2020-2021

Le 1er avril 2021 s’est déroulée la quatrième séance de la troisième série des Panels en réseau de PÉRISCOPE lequel portait sur Peiner à se projeter au-delà de 2020-2021 en lien avec la thématique générale des inégalités et des iniquités scolaires au temps de la Covid-19. Marie-France Boulay (doctorante), Bardo de Jesus Rangel Mendez (doctorant), Caroline Marion (postdoctorante) et Simon Viviers (professeur-chercheur) et d’autres invité·e·s en discutent.
Il semble plus difficile pour des jeunes de conjuguer avec la Covid-19, car leur expérience plus courte leur donne moins de référents à quoi s’attacher pour s’adapter et pour contrer l’incertitude, la peur et le délaissement. C’est dire qu’ils et elles peinent à se projeter dans l’avenir et cherchent entre autres à socialiser comme avant. Ils et elles font toutefois preuve d’agentivité. Leur souffrance peut même les amener à se mobiliser et à agir sur le monde. Développer seul·e sa capacité à se projeter est donc impossible.
La difficulté à se projeter s’empire également si l’on reconnait l’incertitude qu’accompagnent non seulement la pandémie, mais également l’écartement de rites de passage (p.ex. examen ministériel, bal des finissants, rentrée collégiale), la transformation constante du secteur de l'emploi (incluant la popularisation du télétravail), la crise climatique, la surabondance d'informations et l’accélération des activités de production. Ce contexte tend à renforcer un sentiment d’impuissance qui effrite l’agentivité d’une personne face à la situation ainsi que sa capacité à se projeter au-delà de 2021.
Plusieurs dispositions peuvent d’ailleurs expliquer l’incapacité d’une personne à se projeter: (1) percevoir l’impossibilité d’un retour à la normalité, (2) ne pas désirer un retour en arrière étant donné un nouveau confort ressenti, ainsi que (3) perdre de multiple repères quant à ce qu’est sa vie et son quotidien.
Plusieurs pistes prometteuses existent pour compenser la difficulté à se projeter. Une première piste pourrait miser sur une décentration de l’écran, du moins parfois, et où l’on accorde une place plus importante au corporel et au sensible dans l'environnement physique et social de sorte à rejoindre chaque personne de manière bien distincte. Les relations sociales et la reconnaissance d'autrui sont d’autant plus importantes chez ceux et celles qui construisent leur identité. L’espace de socialisation agrandi favorise davantage la découverte de soi par la connexion aux autres. Pour l’instant, les outils technologiques, qui semblent réduire les échanges, aident à pallier à la distanciation qu'imposent les mesures sanitaires, à repenser la gestion d’horaire en réduisant des déplacements couteux et favorisent une nouvelle forme de proximité sociale – encore fragmentaire et qui diminue les occasions de vivre d’heureuses rencontres hasardeuses.
En dehors d’une valorisation de l’espace partagé, une autre stratégie pour compenser la difficulté à se projeter serait d’encourager les personnes, notamment les jeunes, à différer la gratification de leurs actions posées, à développer des compétences transversales, à cultiver un growth mindset, à se diriger vers un champ d’intérêt où se trouvent des opportunités. Cette tâche n’incombe pas seulement à chaque individu, mais également aux instances décisionnelles qui mettent en place des structures qui font le pont entre le monde individuel et social pour faciliter la participation en ces temps difficiles.
Alors que la version complète de la présentation est accessible uniquement aux membres, voici la bande-annonce de ce panel:
L'ex-président de la Fédération des commissions scolaires se prononce sur l'héritage des années Legault
 Selon un bilan critique publié dans Le Devoir, l’héritage des années Legault en matière de « réussite éducative » tient moins à des gains d’apprentissage qu’à une réforme de la gouvernance et à une centralisation du réseau. La loi 40 a réduit les contre-pouvoirs (fin des commissions scolaires élues) et l’État a accru son contrôle sur le discours des centres de services qui ont remplacé les commissions scolaires. Le Conseil supérieur de l’éducation a été aboli, remplacé par l'INEE. Le texte reproche aussi l’absence d’action structurante en matière d’équité, l’« école à trois vitesses », la composition des classes, l’épuisement des personnes enseignantes et l’échec du déploiement à grande échelle des maternelles de 4 ans. Accessible à ce lien.
Selon un bilan critique publié dans Le Devoir, l’héritage des années Legault en matière de « réussite éducative » tient moins à des gains d’apprentissage qu’à une réforme de la gouvernance et à une centralisation du réseau. La loi 40 a réduit les contre-pouvoirs (fin des commissions scolaires élues) et l’État a accru son contrôle sur le discours des centres de services qui ont remplacé les commissions scolaires. Le Conseil supérieur de l’éducation a été aboli, remplacé par l'INEE. Le texte reproche aussi l’absence d’action structurante en matière d’équité, l’« école à trois vitesses », la composition des classes, l’épuisement des personnes enseignantes et l’échec du déploiement à grande échelle des maternelles de 4 ans. Accessible à ce lien.
Les Écoles pionnières (Maroc) : Entre marketing pédagogique et dérive institutionnelle
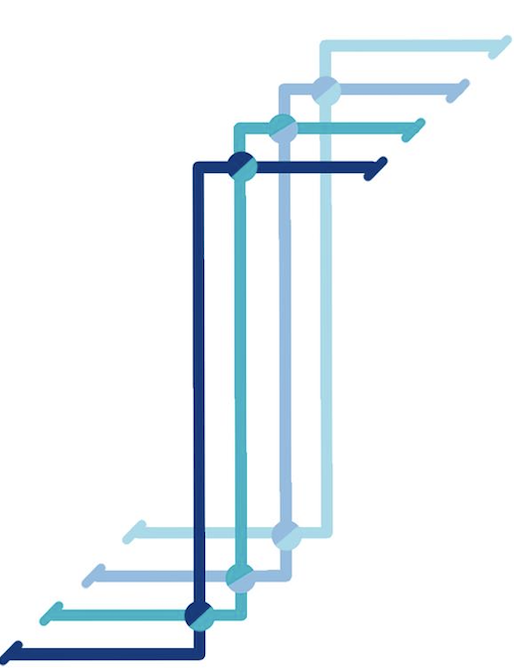 Dans le journal L'Économiste, l'auteur, Naji, décrit un modèle où inspecteurs et enseignants deviennent des «messagers» d’un contenu préformaté, via des leçons «scriptées» et ultra-structurées. Dans cette lecture, l’école se rapprocherait d’une «usine à procédures» : moins d’autonomie, moins d’adaptation au contexte de classe, et une pédagogie rétrécie aux automatismes, au détriment de compétences de haut niveau (pensée critique, résolution de problèmes complexes). Accessible à ce lien.
Dans le journal L'Économiste, l'auteur, Naji, décrit un modèle où inspecteurs et enseignants deviennent des «messagers» d’un contenu préformaté, via des leçons «scriptées» et ultra-structurées. Dans cette lecture, l’école se rapprocherait d’une «usine à procédures» : moins d’autonomie, moins d’adaptation au contexte de classe, et une pédagogie rétrécie aux automatismes, au détriment de compétences de haut niveau (pensée critique, résolution de problèmes complexes). Accessible à ce lien.
SCOPE_3: Une interaction partenariale et concertée École-Famille-Communauté
 Les résultats de recherches d’ici et d’ailleurs convergent : les collaborations entre l’école, la famille et la communauté jouent un rôle crucial dans la persévérance et la réussite scolaires en influençant positivement le développement cognitif, social et émotionnel des élèves. SCOPE 3 présente les éléments saillants du chantier PÉRISCOPE sur les collaborations École- Famille-Communauté (É-F-C), dans la perspective où celles-ci constituent une composante essentielle de la mission éducative. Suivre ce lien.
Les résultats de recherches d’ici et d’ailleurs convergent : les collaborations entre l’école, la famille et la communauté jouent un rôle crucial dans la persévérance et la réussite scolaires en influençant positivement le développement cognitif, social et émotionnel des élèves. SCOPE 3 présente les éléments saillants du chantier PÉRISCOPE sur les collaborations École- Famille-Communauté (É-F-C), dans la perspective où celles-ci constituent une composante essentielle de la mission éducative. Suivre ce lien.
La version allégée, diffusée aux directions des CSS avec une invitation à faire circuler à l'interne est disponible à ce lien.
Compte-rendu synthétique des entretiens Jacques Cartier, 2025
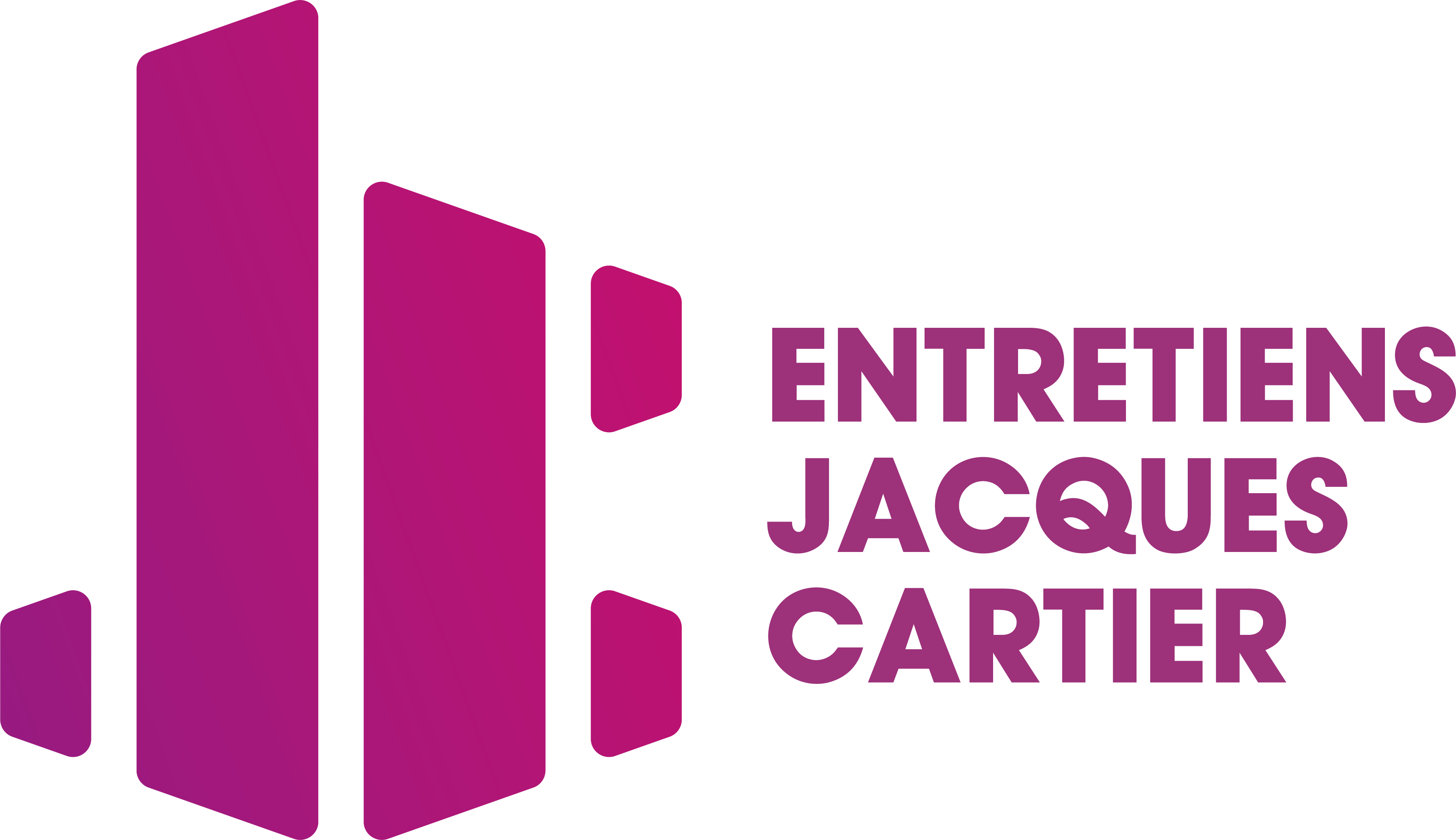 Synthèse rapide qui reprend des éléments du compte rendu de la journée élaboré pour les organisateurs des entretiens Jacques-Cartier. Lesenjeux majeurs soulevés par l’intégration de l’intelligence artificielle générative (IAg) dans les formations universitaires et la recherche touchent à l’équité, à l’intégrité académique, au rapport au savoir, à la pédagogie, à la régulation institutionnelle et, enfin, à la recherche en éducation et en formation. Plus globalement, c’est la réussite scolaire et éducative qui est questionnée. Suivre ce lien.
Synthèse rapide qui reprend des éléments du compte rendu de la journée élaboré pour les organisateurs des entretiens Jacques-Cartier. Lesenjeux majeurs soulevés par l’intégration de l’intelligence artificielle générative (IAg) dans les formations universitaires et la recherche touchent à l’équité, à l’intégrité académique, au rapport au savoir, à la pédagogie, à la régulation institutionnelle et, enfin, à la recherche en éducation et en formation. Plus globalement, c’est la réussite scolaire et éducative qui est questionnée. Suivre ce lien.
périSCOPE 2: Savoirs croisés Outillant une Participation Engagée
 Voici le deuxième SCOPE de cette série, appellation retenue en écho à la deuxième moitié de l'acronyme du réseau (PÉRISCOPE). Intitulé Susciter l’engagement dans les apprentissages, ce SCOPE est associé au premier niveau de participation auquel le Réseau s'est intéressé, soit la participation de l'élève dans la classe. Ce fut un chantier mené sur plusieurs années et qui a mobilisé plusieurs chercheur·es et partenaires. Suivre ce lien.
Voici le deuxième SCOPE de cette série, appellation retenue en écho à la deuxième moitié de l'acronyme du réseau (PÉRISCOPE). Intitulé Susciter l’engagement dans les apprentissages, ce SCOPE est associé au premier niveau de participation auquel le Réseau s'est intéressé, soit la participation de l'élève dans la classe. Ce fut un chantier mené sur plusieurs années et qui a mobilisé plusieurs chercheur·es et partenaires. Suivre ce lien.